Je ne sais pas si vous vous souvenez, en janvier je devais donner une conférence autour de l’amour dans les contes de fées mais elle a été annulée pour cause de cocovid. Cet article est le premier d’une série où je vais vous livrer la version écrite de mes notes, histoire de ne pas avoir travaillé dans le vent :p
Les contes, leurs multiples versions & Disney
Avant de nous plonger dans les travers amoureux des personnages de contes, je voulais faire un petit point avec vous sur l’origine de ces histoires.
Les contes, tels qu’on les connait aujourd’hui, ont été retranscrits à l’écrit, dans des recueils, entre le 17ème et le 19ème siècle par des auteur très connus comme Grimm, Andersen ou Perrault, même s’il y en a eu d’autres. Mais ces récits sont, pour la plupart, beaucoup plus anciens. Les auteurs qui les ont mis en recueil ont pioché dans la tradition orale, c’étaient des histoires que l’on se racontait et qui, par leur nature même, n’étaient pas figées. Elles pouvaient varier un petit peu en fonction de qui les contaient, des pays, des époques … C’est ainsi que l’on se retrouve avec des dizaines de versions avérées pour certains contes. Je pense notamment à Cendrillon dont il existe une multitude de variantes.
Ceci étant posé, on comprend facilement que ces histoires sont par essence faites pour qu’on se les approprient, qu’on les remodèle, qu’on les raconte à notre manière. Et c’est pour ça qu’elles se prêtent si bien à la réécriture et à la réinterprétation, encore de nos jours. On ne compte pas les films, les livres ou les séries qui retravaillent la matière des contes de fées.
Les plus célèbres étant, évidemment, les dessin-animés des studios Disney. Qu’on les aime ou pas, presque tout le monde en a vu au moins un et ils ont participé à démocratiser les histoires, parfois un peu oubliées, des contes. Dans le processus, ils ont contribué à propager une image un peu mièvre des contes de fées. C’est vrai qu’aujourd’hui quand on pense aux contes, on s’imagine souvent des histoires de princes et de princesses, de chevaliers servants et de jouvencelles en détresse. Et même dans notre façon de parler, on associe les contes à l’amour. Beaucoup rêvent de rencontrer un « prince charmant » ou de vivre une « histoire de contes de fées. »

Mais est-ce que les histoires originelles des contes, avant que Disney ne passe par là, présentaient bien des relations amoureuses dignes de faire rêver les lecteurs ? C’est ce que nous allons voir aujourd’hui 😉
La Reine des neiges : l'histoire d'amour qui n'existait pas.
Inutile de faire durer le suspense plus longtemps, les histoires d’amour que l’on trouve dans les contes sont souvent bien différentes que ce qu’en ont fait les adaptations. Bien souvent, on trouve même des intrigues romantiques là où il n’y en avait pas du tout.
Ce cas de figure se retrouve notamment dans La Reine des Neiges. Alors, il existe un dessin animé soviétique de Lev Atamanov qui date 1957, assez méconnu, en revanche personne n’est passé à côté du phénomène planétaire qu’a suscité l’adaptation Disney en 2013. Dans ce long-métrage on nous raconte l’histoire de deux sœurs Anna et Elsa, la première essayant de retrouver et de sauver la seconde qui ne parvient pas à maitriser ses pouvoirs de glace et qui s’enfuit dans la nature gelée.
Je ne saurais presque pas par où commencer pour vous expliquer à quel point cette histoire est éloignée de celle du conte. Du coup, je vais vous citer le producteur Peter Del Vecho qui dit « il y a de la glace, il y a de la neige, il y a une reine, mais à part ça on s’éloigne un peu » et ma foi il ne pourrait pas si bien dire.
Le conte original a été écrit par Hans Christian Andersen et publié en 1844. C’est un conte assez long qui se déploie sur 7 chapitres. Il nous raconte l’histoire de Kai et Gerda, deux enfants liés par une amitié assez touchante. Un jour, Kai reçoit dans le cœur et dans les yeux de tous petits éclats d’un miroir fabriqué par le diable et il devient incapable de voir la beauté. Quelques temps plus tard, la reine des neiges vient le chercher et l’emmène dans son palais de glace. La petite Gerda va alors se lancer toute seule dans un périple pour le retrouver et le sauver.
Entre le Disney et le conte on a en commun le thème du voyage pour retrouver un être cher qui n’est pas lié à une idylle, puisque Anna cherche sa sœur et Gerda son ami. Mais à peu de choses près, ça s’arrête là.

La figure de la Reine des Neiges elle-même est diamétralement opposée d’une œuvre à l’autre. Si à la base du projet, Elsa devait être l’antagoniste du Disney, ils se sont ravisés. Le long métrage construit l’image d’Elsa, des souvenirs de son enfance jusqu’au point culminant de la construction de son palais, en faisant en sorte qu’elle suscite de l’admiration, de la compassion. Le spectateur sait qu’elle n’est pas mauvaise même si son peuple pense le contraire.
A l’inverse, dans le conte, c’est un être de légende, qui, avant d’apparaître, est évoqué par la grand-mère de Gerda sans aucun jugement de valeur. On ne dit jamais si elle est bonne ou si elle est mauvaise. On sait juste qu’elle commande la neige. C’est un personnage assez éthéré, insaisissable, qui n’apparait que trois fois dans le texte et dont on ne connait ni le passé ni les intentions. Elle suscite beaucoup de mystère et on comprend que le champ est assez libre pour que les adaptations puissent explorer ce personnage et combler les zones d’ombre qu’il porte.
Quoiqu’il en soit, Elsa et la reine du conte dégagent des choses très différentes. Je trouve que la reine des neiges d’Andersen présente plutôt une posture similaire à celle de Jadis dans la saga Narnia de Lewis. Le voyage en traineau, le petit garçon enlevé à son entourage, l’ambiguïté et le côté inquiétant … On est vraiment sur le même type de personnage.

Le conte est assez innovant et met à mal beaucoup de clichés. Il n’y a pas de jouvencelle en détresse, au contraire c’est une petite fille qui va sauver un garçon. Quand Anna est très épaulée, protégée et guidée par Christophe, Gerda se débrouille toute seule. C’est un personnage puissant.
Un fait intéressant : elle est pieds nus. Or les chaussures sont dotées d’une symbolique assez forte dans ce conte : la reine des neiges promet à Kai de lui offrir des chaussures et de le libérer quand il aura réussi à écrire le mot liberté avec des éclats de glace. Gerda, elle, abandonne volontairement ses chaussures, elle cherche à dépasser sa condition et à aller au-delà de ce qu’elle était au début du conte. Quand Anna rêve de se marier avec Hans, un type qu’elle vient tout juste de rencontrer.
Gerda, si elle demeure seule, va croiser la route de beaucoup d’autres personnages qui sont presque tous des personnages féminins très impactants. Je pense notamment à la princesse chez qui elle séjourne qui a choisi son mari en fonction de son intelligence parce qu’elle voulait avec des conversations intéressantes toute sa vie. Et c’est quand même assez rare, dans les contes, de trouver un mariage construit sur des échanges intellectuels pour être souligné !
On a donc pas moins de huit personnages féminins très forts dans le conte d’Andersen, quand le Disney présente certes deux héroïnes mais entourées de protagonistes masculins. Outre sauver Elsa et tout ce qui tourne autour de la sororité, les histoires d’amour occupent tout de même une place centrale dans le récit avec Anna qui oscille entre Hans et Kirstoff et dont les liaisons vont avoir des conséquences directes sur l’intrigue.
Alors que le conte ne présente qu’une jolie histoire d’amitié, mise en lumière par le parcours initiatique d’une fillette courageuse et volontaire.
Si cet article vous a intéressé, rendez-vous dans deux semaines pour celui sur La Petite Sirène 😀
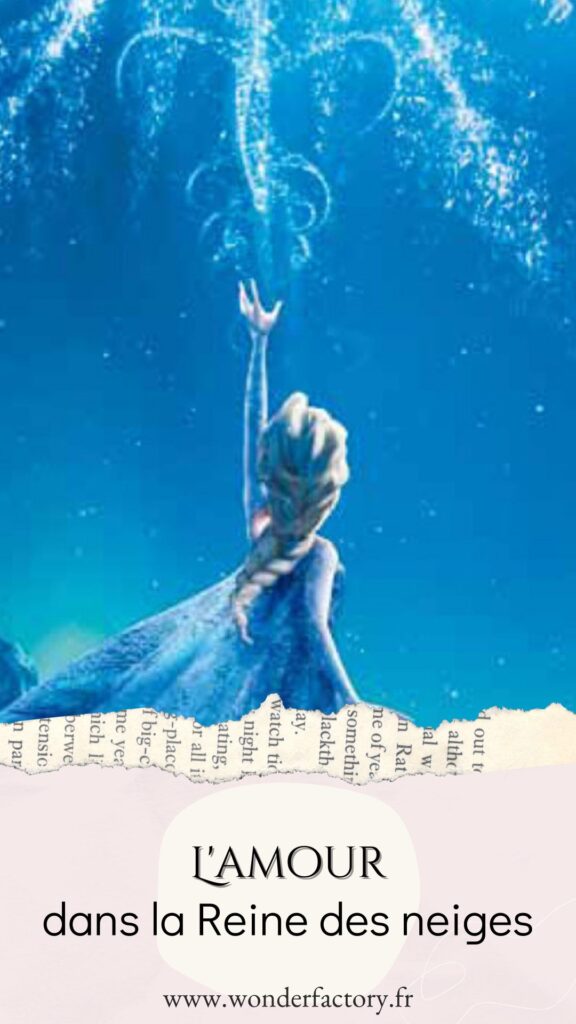

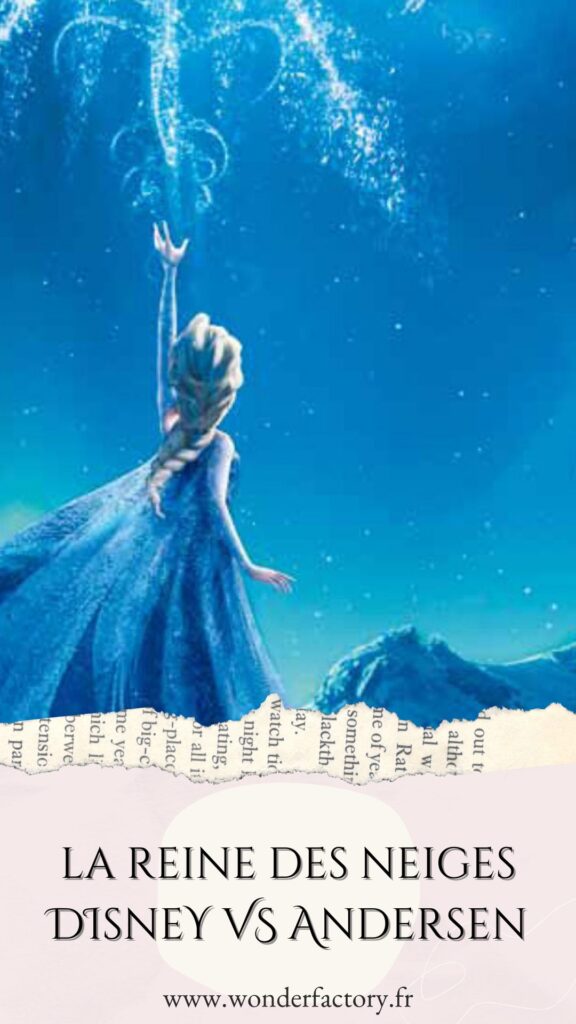
Le saviez-vous ? J’ai fondé une maison d’édition spécialisée dans les réécritures de contes de fées, pour découvrir nos ouvrages c’est par ici : Magic Mirror éditions.



